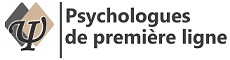Hikikomori : un phénomène à définir, est-il considéré comme un trouble ?
Le terme « hikikomori », d’origine japonaise, désigne un état d’isolement social prolongé, généralement observé chez des adolescents et des jeunes adultes. Ces individus choisissent de se retirer de la vie sociale pendant de longues périodes, souvent pendant six mois ou plus. Cette forme de retrait peut être volontaire ou résulter d’une incapacité à faire face aux exigences de la vie sociale. En se cloîtrant chez eux, ces jeunes évitent les interactions sociales, qu’il s’agisse de la famille, des amis ou même des étrangers, et peuvent passer des jours, voire des mois, sans sortir de chez eux.
Reconnaissance en tant que Trouble de la Santé Mentale
La question de savoir si le hikikomori doit être considéré comme un trouble de la santé mentale est un sujet de débat parmi les professionnels de la santé. À l’heure actuelle, il n’est pas inscrit dans des classifications reconnues comme le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) ou la CIM-10 (Classification internationale des maladies). Cela signifie qu’il n’existe pas de cadre diagnostique formel pour le hikikomori, ce qui complique la reconnaissance et la prise en charge des personnes touchées.
Cependant, des études et des observations cliniques montrent que les personnes vivant ce phénomène présentent souvent des symptômes associés à des troubles psychologiques tels que l’anxiété sociale, la dépression et parfois des troubles de la personnalité. Par conséquent, même si le hikikomori n’est pas reconnu comme un trouble à part entière, il est souvent intégré dans les discussions sur la santé mentale en raison de ses liens avec des pathologies existantes. Les experts s’accordent à dire que les personnes touchées par le hikikomori peuvent bénéficier d’un soutien psychologique, et des approches thérapeutiques comme la thérapie cognitive-comportementale (TCC) ont montré des résultats prometteurs.
Dimensions Socioculturelles
Il est essentiel de comprendre le hikikomori non seulement comme un phénomène individuel, mais également comme une manifestation de facteurs socioculturels plus larges. Au Japon, la société est souvent caractérisée par des attentes élevées en matière de réussite académique et professionnelle, ce qui crée un environnement de compétition intense. Cette pression peut engendrer des niveaux élevés d’anxiété et de stress, poussant certains jeunes à se retirer pour éviter l’échec ou le jugement.
De plus, la montée des technologies numériques et des interactions virtuelles a modifié la nature des relations sociales. Alors que les réseaux sociaux peuvent offrir des opportunités de connexion, ils peuvent également exacerber le sentiment d’isolement pour ceux qui ont des difficultés à établir des relations authentiques. Dans ce contexte, le hikikomori devient un miroir des défis contemporains, où le retrait social peut être perçu comme une réponse à des attentes irréalistes et à une incapacité à naviguer dans des environnements sociaux complexes.
Les Conséquences de l’Isolement
L’isolement prolongé associé au hikikomori peut avoir des conséquences significatives sur la santé physique et mentale des individus concernés. Les personnes en état de hikikomori peuvent éprouver des problèmes de santé tels que l’anxiété chronique, la dépression, et même des troubles alimentaires. De plus, la privation d’interactions sociales peut mener à une détérioration des compétences sociales et à une difficulté accrue à réintégrer le monde extérieur.
Sur le plan physique, l’isolement peut également entraîner des problèmes de santé liés à l’inactivité, comme l’obésité, des troubles musculo-squelettiques, et d’autres complications liées à un mode de vie sédentaire. Les implications vont au-delà de la santé individuelle et touchent aussi la famille et la communauté, créant un cercle vicieux de soutien et d’interaction sociale affaibli.
Approches de Traitement et d’Intervention
Pour aborder le phénomène du hikikomori, des stratégies d’intervention variées sont nécessaires. Les approches doivent être holistiques, tenant compte à la fois des dimensions psychologiques et socioculturelles. Les thérapeutes recommandent souvent des méthodes qui favorisent une réintégration progressive dans la société. Cela peut inclure :
Thérapie Psychologique :
Des interventions telles que la thérapie cognitive-comportementale (TCC) peuvent aider à traiter les symptômes d’anxiété et de dépression, en offrant des outils pour gérer les pensées négatives et développer des compétences sociales.
Programmes Communautaires :
La création de programmes de soutien communautaire, où les jeunes peuvent interagir dans un cadre sécurisant et non menaçant, peut faciliter la réintégration sociale.
Soutien Familial :
Engager la famille dans le processus thérapeutique peut être crucial, car les dynamiques familiales jouent souvent un rôle clé dans le phénomène du hikikomori. Des séances de conseil familial peuvent aider à améliorer la communication et à réduire les tensions.
Utilisation des Technologies :
Des solutions numériques peuvent également être envisagées pour aider à créer des réseaux de soutien, permettant des interactions sociales tout en respectant le rythme des individus en retrait.
Le hikikomori est un phénomène complexe qui soulève des questions sur la santé mentale, les dynamiques sociales et les pressions culturelles contemporaines. Bien qu’il ne soit pas officiellement reconnu comme un trouble de la santé mentale, son impact sur le bien-être psychologique et social des individus est indéniable. Pour mieux comprendre et traiter le hikikomori, il est crucial d’adopter une approche intégrative qui tient compte des dimensions individuelles et socioculturelles. Cela permettra de développer des stratégies d’intervention plus efficaces et de soutenir ceux qui se trouvent piégés dans l’isolement, les aidant ainsi à retrouver leur place dans la société.
Articles similaires:
- Tout ce qu’il faut savoir sur l’anxiété liée à la sensibilité au bruit
L’anxiété liée à la sensibilité au bruit est une condition qui touche de nombreuses personnes, affectant leur bien-être et leur... - Quelle est votre réaction face à la dépression induite par l’arrêt du tabagisme ?
Arrêter de fumer est une décision courageuse et bénéfique pour la santé, mais ce processus n’est pas sans défis. L’un... - 6 conseils de coaching de vie pour les mamans et les parents
La vie de parent peut apporter beaucoup de joie, mais aussi quelques difficultés dans ce changement de vie. Nous vous... - Symptôme somatique et troubles connexes
Le trouble symptomatique somatique (anciennement connu sous le nom de « trouble de somatisation » ou « trouble somatoforme» est...
Les psychologues du centre
Psychothérapie … pour tous
Informations générales concernant la thérapie
Des difficultés relationnelles, le stress au travail ou à l’école, des expériences traumatisantes, etc… peuvent être la cause des problèmes psychologiques. Mais bien souvent, on n’arrive pas à savoir quelle est réellement la raison de ce « mal-être ». Parfois, la solution viendra de vous-même, de votre famille ou de vos amis. Mais dans le cas contraire; consulter un psychologue peut vous aider. Votre médecin généraliste peut vous adresser à un psychologue mais vous êtes aussi libre d’en choisir un par vous-même.